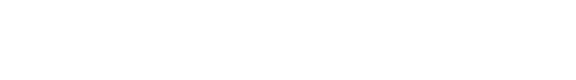Interdiction des voitures thermiques d'ici 2035 : un risque réel pour les classes moyennes
Le chemin vers 2035 s'annonce tumultueux pour les voitures thermiques en France et en Europe. Retour sur le débat et ses implications.

Un projet ambitieux pour l'avenir
À l’horizon 2035, l'Union européenne a fixé un cap ambitieux : interdire la vente de véhicules thermiques neufs sur son territoire. Ce projet finalement adopté vise à accompagner le continent vers une neutralité climatique d'ici 2050. Dans ce contexte, le secteur du transport, responsable d'environ 20% des émissions de CO2 dans l'UE, est une priorité. Le plan prévoit de réduire les émissions des voitures de 55% d'ici 2030 par rapport à 2021, ouvrant la voie à un avenir où seules les voitures zéro émission seront vendues après 2035.
En France, le gouvernement avait initialement prévu l'interdiction des ventes de voitures thermiques en 2040, mais a dû ajuster ces ambitions face aux objectifs de l'UE. La date a ainsi été avancée à 2035 conformément au règlement européen de 2023, marquant l'urgence économique et environnementale de cette transition. Toutefois, les implications sociales et économiques pour la filière automobile et les consommateurs restent au centre des débats politiques nationaux.
Le vote controversé à l'Assemblée nationale
Récemment, l'Assemblée nationale française a vu un vote symbolique, mais peu déterminant, rejeter de justesse l'inscription de la date de 2035 dans le droit français, malgré la primauté du droit européen. Ce sont 34 députés, principalement du Rassemblement national, qui ont soutenu cet amendement contre 30 opposants. Le député RN Matthias Renault a souligné le danger financier pour les ménages et l'industrie : "Pour les ménages les plus modestes, l'achat d'une voiture électrique représente un coût qui est assez inabordable".
Face à cet obstacle, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Industrie et de l'Énergie Marc Ferracci, a défendu l'objectif de 2035, insistant sur les progrès déjà réalisés dans l'électrification du secteur automobile. Des discussions européennes continues et une clause de revoyure en 2026 laissent toutefois la porte ouverte à des ajustements futurs selon les progrès réalisés et les réalités du marché.
Les implications juridiques et politiques
Malgré ce vote à l'Assemblée, le règlement européen reste en vigueur, et la transition est inévitable tant qu’elle répond aux décisions européennes. La "mise au propre" du droit français n’a pas pu se faire, mais l’effet direct de la réglementation européenne garantit l'application de l'interdiction en 2035. Comme l’a expliqué l’avocat Arnaud Gossement à France Info (source), ce rejet n’est qu'une expression politique sans impact pratique immédiat : "L'amendement a juste empêché de nettoyer le droit français, mais ça ne change rien d'autre. C'est de la pure politique".
Des voix politiques continuent de s’élever contre cette marche européenne, certains appelant même à revoir la primauté du droit européen sur le national. Le débat n’en est donc pas à son terme, particulièrement avec l’échéance parlementaire de la clause de revoyure en 2026.
Conclusion et perspectives
Alors que la France débat vigoureusement, l'ombre de 2035 plane sur tous les acteurs concernés. Les constructeurs automobiles réclament en parallèle plus de flexibilité pour s'adapter en respectant les amendes et objectifs de réduction d'émissions. Ce vaste chantier appelle à une introspection sur l'évolution industrielle et les capacités d'adaptation de notre société. En attendant, les regards se tournent vers les institutions européennes, seul organe véritablement habilité à réévaluer ou réaffirmer ce règlement fondamental pour l'avenir climatique. La route vers la mobilité propre semble pavée d'obstacles, mais la détermination à les surmonter est palpable.