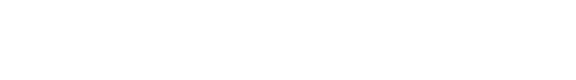Contrôle technique, radars, ZFE : les automobilistes, vaches à lait de la République ?
À mesure que les politiques publiques se raffinent, l'automobiliste français se demande s’il n’est pas devenu l'involontaire pourvoyeur de fonds d'une République en quête de recettes.

Un contexte de coûts global en constante augmentation
L'année 2024 n'a fait qu'accentuer le fardeau financier pesant sur les automobilistes. Avec un carburant flirtant avec la barre symbolique des 2 euros le litre, et une tendance qui ne semble pas s'inverser, bien au contraire (autojournal.fr, 2024). L'inflation récente n’a épargné aucun secteur, affectant également le coût des réparations automobiles. Selon le baromètre 2024 d’iDGarages, les prix ont augmenté de 7% entre 2023 et 2024.
La technologie croissante dans les véhicules modernes complexifie les réparations, se traduisant par une envolée des coûts. Quant au contrôle technique, il atteint aujourd’hui un prix moyen de 79€ d'après une étude simplauto.com, voire plus dans certaines régions (jusqu'à 120 euros !). En plus de cela, depuis les réformes de 2018, les contre-visite ne sont plus offertes comme cela était le cas avant, en guise de geste commercial.
Cette hausse globale des coûts alimente la perception que les automobilistes sont une source de revenus inépuisable.
Les radars automatiques : un jackpot pour l’État
Les radars automatiques constituent une manne financière non négligeable pour les caisses de l'État. En 2022 déjà, les recettes issues de ces dispositifs avaient atteint 707 millions d’euros, en hausse de 8 % par rapport à l’année précédente (caradisiac.com). Cette tendance à l’augmentation pourrait bien se maintenir avec les nouveaux dispositifs de 2025 (voir notre article sur les voitures radars et l'intelligence artificielle).
Bien que ces dispositifs soient souvent justifiés par des raisons de sécurité routière, près de la moitié des recettes n’alimentent pas directement les mesures de sécurité, ce qui alimente un sentiment d'exploitation parmi les conducteurs.
ZFE : la double peine pour les zones périurbaines
En plus de tout cela, 2025 marque l'arrivée des zones à faibles émissions (ZFE) obligatoires dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ces zones, instaurées pour réduire la pollution, impliquent des restrictions de circulation pour certains véhicules en fonction de leur vignette Crit’Air. Pour de nombreux habitants en périphérie, cela représente une double peine :
- Des habitants forcés de changer de véhicule (sans aide suffisante).
- Des professionnels exclus de certains marchés faute de pouvoir accéder aux villes.
- Une impression d’injustice territoriale croissante
Le problème ? Dans de nombreuses communes de grande couronne, aucune alternative sérieuse en matière de transports en commun n’est disponible, augmentant ainsi la frustration des résidents périurbains.
Vers une rupture entre l’État et les automobilistes ?
L'accumulation des taxes, amendes, et restrictions nourrit un ressentiment palpable chez les automobilistes. S’ajoutant aux contraintes économiques actuelles, le spectre d’une rupture n’est pas à écarter.
Pour éviter ce fossé croissant, un rééquilibrage des mesures fiscales s'avère essentiel, afin de rendre ces politiques plus acceptables et équitables pour l'ensemble des usagers de la route. En somme, l'État devra prouver que le revenu généré par ces mesures sert véritablement à améliorer la sécurité routière et l'environnement, plutôt qu'à combler les déficits budgétaires.